À l’occasion de la présentation du projet de loi sur la décentralisation présenté mercredi dernier en conseil des ministres, nous vous proposons la relecture de l’article de Roger Martelli, publié dans le e-mensuel Regards de janvier, sur les enjeux d’une telle réforme.
En octobre dernier, François Hollande annonçait une nouvelle
loi de décentralisation, chassant de fait celle de Brice
Hortefeux, promulguée en 2010 et raccord avec le projet
libéral sarkozien. Qu’en sera-t-il de la suivante ?
La loi Hortefeux faisait
suite à vingt-six rapports
et études confectionnés
entre le printemps 2005
et le printemps 2009.
Elle était construite autour de quatre
objectifs : réorganiser les collectivités
autour de deux pôles, un pôle départements-
région et un pôle communesintercommunalité
; simplifier le paysage
institutionnel en achevant la couverture
intercommunale du territoire national et
en élargissant le cadre des intercommunalités
; créer un cadre institutionnel
métropolitain ; clarifier les compétences
des différents niveaux de collectivités
et encadrer la pratique des cofinancements.
Le gouvernement Fillon entendait
donc réduire l’exception française
des 37 000 communes, redéfinir les
fonctions territoriales avec la fin de la
« clause de compétence générale » [[La clause de compétence générale permet aux collectivités territoriales d’agir pour
des missions qui ne sont pas de leurs compétences, dès l’instant où la loi ne l’interdit
pas explicitement.]].
et réformer complètement la représentation
des territoires avec l’introduction
de « conseillers territoriaux » se substituant
aux conseillers généraux et régionaux.
Le maillage territorial français devait
entrer ainsi dans la troisième grande
inflexion de son histoire contemporaine.
La première s’était étalée sur près d’un
siècle, grosso modo entre la création
des départements en 1790 et la loi
municipale de 1884, qui consacrait
l’élection des maires et des adjoints et
la publicité des séances. Cette longue
période a conjugué la rationalisation
administrative de l’État central et l’affirmation
progressive de la démocratie
communale. La seconde phase, plus
ramassée, va des années 1960 au début
des années 1980 : elle a vu tout à
la fois émerger de nouveaux territoires
(l’Europe et la région) et s’imposer le
paradigme de la décentralisation, au
départ pour décongestionner les services
de l’État en les déconcentrant.
Dans le même temps, l’État a amorcé en
1973 (mise en place des « contrats de
pays ») un long mouvement de désengagement,
au profit d’autres acteurs,
publics et privés. En 2007, le processus
s’est entremêlé avec la mise en place
de la Réforme générale des politiques
publiques (RGPP), qui fait de la réduction
de la dépense l’alpha et l’oméga de
toute bonne gestion administrative. Le
redécoupage territorial, en cherchant à
mettre un terme au « mille-feuille » administratif,
devenait dès lors un passage
obligé pour parvenir à une redéfinition
plus modeste des objectifs publics.
L’ère de la concurrence
L’ambition de 2007-2012 voulait déplacer
les visées globales de l’aménagement
territorial. Dans les deux
premières phases dominait la préoccupation
d’un rééquilibrage, dans la
lignée du constat alarmiste de Jean-
François Gravier en 1947 (Paris et le
désert français) et autour des notions
de compensation et de solidarité des
territoires. Dans la troisième phase, au
contraire, la polarisation territoriale est
tenue pour un effet salutaire de la compétitivité.
En fait, un territoire ne vaut
que s’il se dote des moyens qui lui permettront
de s’inscrire dans une concurrence
générale avec tous les autres.
On « n’aménage » pas l’espace pour
l’égaliser : on assume sa polarité. Dans
le sigle de l’instrument historique de
l’aménagement du territoire, la DATAR,
« l’action régionale » s’efface au profit de
« l’attractivité régionale » [[Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale, devenue Délégation
interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires (DIACT) en
2005, puis Délégation à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale.]].
Il ne s’agit plus de distribuer égalitairement
les services publics ou d’obtenir
une péréquation des ressources
par la fiscalité. La logique nouvelle se
condense en trois grands volets : l’État
soutient les pôles d’ores et déjà les plus
attractifs à l’échelle européenne ou mondiale
(« pôles de compétitivité », « pôles
d’excellence rurale », « plan Campus ») ;
les collectivités entrent en compétition
et valorisent leur territoire en mobilisant
l’initiative privée ; les régions et les départements
refondus pansent les plaies
en procédant à de la redistribution à la
marge. Les phases précédentes se préoccupaient de contenir le processus
de marginalisation et de désertification
des espaces faiblement compétitifs ; la
nouvelle veut prioritairement relier les
pôles d’excellence, dans le cadre d’une
métropolisation accentuée.
La Révolution française avait fait du
département le pivot territorial de l’État
et la IIIe République avait institué la
commune comme l’unité de base de
la citoyenneté. Pour la droite « décomplexée
» d’après 2007, l’objectif est
de rendre possible la « bonne gouvernance
» d’un couple fonctionnel qui
n’est plus celui du département et de la
commune, mais celui des blocs régiondépartement
et métropole-intercommunalité.
L’État orienteur et aménageur,
qui était au coeur de la tradition historique
du bonapartisme-gaullisme, est
mort : l’affectation des ressources obéit
à la « pure » loi des marchés et l’État
ne fait qu’accompagner et garantir la
régularité des contrats qui délimitent
les positions respectives des acteurs.
L’alignement concurrentiel des gestions
publiques, la limitation des impôts sur
l’appareil productif, le contingentement
des dépenses publiques (notamment
en personnel), le recul des dotations d’État et la compétitivité des territoires
vont de pair.
Un vrai changement ?
Quant à la décision publique, elle doit
abandonner toute obsession de la règle de
représentation. La démocratie n’est plus
le critérium du fonctionnement institutionnel,
qui est désormais celui de la gouvernance
: les élites de la société civile procèdent
à l’expertise, au choix et à l’évaluation,
sur la base de l’acceptation intégrale des
normes du marché concurrentiel. De
2007 à 2012, la simplification présidentialiste,
le bipartisme de type anglo-saxon
et la refonte territoriale sont trois pièces
d’un même projet, autour d’une ambition
sans précédent. La décentralisation ellemême
se vide de contenu en laissant la
place à une véritable recentralisation de
la ressource. Les collectivités sont théoriquement
autonomes, mais dans un cadre
financier totalement contraint : suppression
de la taxe professionnelle, inflation
des normes techniques et imposition de la
« règle d’or » au budget des collectivités.
Que vont faire les socialistes au pouvoir
? Pour l’instant, les seuls éléments
acquis sont l’abandon de l’institution des
conseils territoriaux, le retour à la clause
de compétence générale et la création
d’un Haut-Conseil des territoires ouvert
aux exécutifs territoriaux. Pour le reste,
tout est en pointillé. On ne sait pas grandchose
du cadre financier envisagé ou de
la répartition des compétences, en dehors
de vagues indications sur la spécialisation
des rôles. On ne sait rien non plus des
dispositifs d’élection envisagés, hors la
curieuse modalité d’un scrutin cantonal
binominal majoritaire.
Le risque est que les socialistes se livrent
à quelques ajustements tactiques sans
toucher sur le fond à l’architecture précédemment
mise en place. Auquel cas,
la cohérence de projet resterait entre
les mains d’une droite ouvertement libérale-
sécuritaire et le socialisme mettrait
la gauche française à la remorque d’une
logique sociale-libérale à l’anglo-saxonne.
Le sens général d’une mondialisation
financière et libérale étant totalement intériorisé,
il ne resterait à la gauche que le
recours à des redistributions à la marge et
à la valorisation d’un ordre social garanti,
présumé plus efficace que l’ordre ultra-libéral
parce qu’il serait plus « juste ».
Recul de l’État et politique sécuritaire « de
gauche » serait l’horizon officiel. Si cela
était, il conviendrait que, bien à gauche, se
formule la seule voie possible : celle d’une
cohérence alternative. La droite raccorde
la déréglementation, la compétitivité et la
« bonne gouvernance ». Opposons-lui, à
toutes les échelles, le bien commun et le
partage, le développement des capacités
humaines et la démocratie d’implication.
C’est sur cette seule base que la recomposition
des territoires peut s’envisager,
ce qui implique que la réforme financière
et fiscale, la réforme institutionnelle générale
et celle des collectivités territoriales
devraient ouvertement s’agencer.
Communes et communautés de communes
La France comptait 44 000 communes en 1790, 37 500 en 1860
et 36 683 en 2012.
Le tableau suivant porte sur les communautés de communes (EPCI)
à fiscalité propre, c’est-à-dire dont le financement est assuré par le
recours à la fiscalité directe locale.

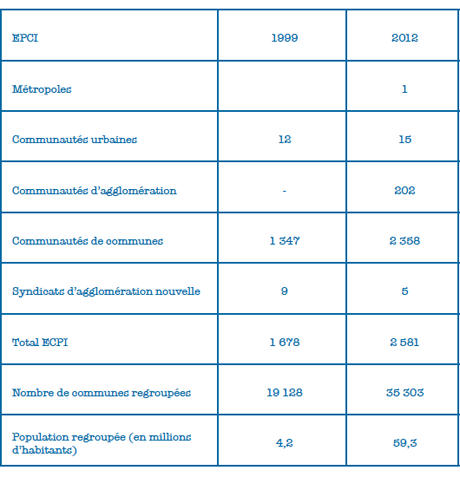


Laisser un commentaire