Jacques Julliard est un historien fécond. Il est « né » avec la « seconde gauche » des années 1960, il a prôné la « République du centre » au milieu des années 1980. Il fait aujourd’hui le constat que la social-démocratie est arrivée au bout de ce qu’il appelle sa deuxième phase, celle qui commence avec la Libération et l’essor de l’État-providence. Prenant acte des impasses du social-libéralisme à la Tony Blair, Julliard plaide pour que l’avènement de François Hollande marque l’émergence d’une « social-démocratie de troisième génération ». Cette conviction s’appuie sur un parcours historien ambitieux, de Rousseau à nos jours. Reprenant et amplifiant des travaux antérieurs, l’ancien observateur érudit du syndicalisme révolutionnaire nous offre l’image d’une gauche structurée en quatre grandes familles, libérale, jacobine, collectiviste et libertaire.
Le propos, solidement étayé, est toujours intéressant. Ce n’est pas le sous-estimer que de dire que ces hypothèses ne sont pas nécessairement convaincantes et que l’imaginaire de la gauche qu’il reconstitue pour nous peut sembler quelque peu… imaginaire. La « gauche libérale » – celle de Sieyès et de Constant – n’a existé, à la limite, que tant que le conflit majeur opposait l’Ancien régime et la société nouvelle ; une fois dépassé le conflit, cette gauche – qui réduit le champ de l’égalité à l’égalité en droit – n’a donc pas d’héritiers. La « gauche jacobine », que Rocard et la CFDT aimaient pourfendre naguère, entretient la vieille confusion entre le jacobinisme (la centralisation révolutionnaire) et le bonapartisme (la centralisation administrative d’État, de souche monarchiste). Or la différence radicale entre les deux modes de centralisation installe une délimitation nette entre la gauche et la droite (de ce fait, contrairement à ce que dit Julliard, il n’y a pas plus de droite « jacobine » que de gauche « libérale »). La notion de « gauche collectiviste » tend à confondre l’attrait du commun – et du « communisme » – et la propension étatiste, qui n’en est pas le débouché nécessaire. Enfin la « gauche libertaire » ignore la tension fondamentale entre ce que l’on pourrait appeler un « social-libertarisme » ancré à gauche et un « libéral-libéralisme » aux limites de la gauche et de la droite.
Au final, la typologie de Julliard nous offre une image qui relève plus d’une taxinomie un peu datée et figée, que d’une dynamique toujours à l’œuvre. S’il est une logique historique de distribution des comportements et des cultures, on peut préférer la trouver dans une double polarité, qui se superpose à celle de la gauche et de la droite. La principale, à la fois permanente et mouvante, distingue la tendance à l’intégration dans les logiques dominantes, pour obtenir des marges d’égalisation, et le désir de rupture pour contredire radicalement les dynamiques structurelles d’inégalité. C’est, sous des formes toujours changeantes, le vieux dilemme de la réforme et de la révolution. L’autre pôle, qui se surajoute au premier, sépare la recherche de l’auto-organisation et la tentation du recours à l’État, on aurait dit naguère de l’étatisme et de l’autogestion. Adaptation ou subversion d’un côté ; autonomie ou hétéronomie de l’autre… Cette double polarité me paraît plus mobile et plus pertinente pour penser en longue durée le champ de la gauche. En longue durée et donc aujourd’hui encore.
Disons franchement que le profil, à peine suggéré – l’ouvrage s’attache à la rétrospective davantage qu’à la prospective –, d’une social-démocratie de troisième génération laisse quelque peu perplexe, dans un espace mondialisé et soumis à une crise systémique inédite. Il n’en reste pas moins que Julliard a le mérite de suggérer à toute la gauche, et pas seulement à la social-démocratie, que le temps est venu du renouvellement et de nouvelles synthèses : sur l’égalité (son ami Rosanvallon nous y pousse aussi instamment), sur la liberté et sur la dialectique, éternelle mais radicalement subvertie désormais, du collectif et de l’individu.
Un défi à relever…
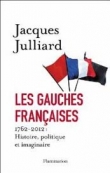
Laisser un commentaire