Trois ans déjà que la zone
euro est secouée par la
crise de sa dette publique.
La faute à une construction
bancale de l’Union
monétaire qui impose
l’austérité tout en exigeant
de la croissance. Equation
difficile à résoudre dont les
ingrédients, compétitivité
salariale et appel aux
capitaux privés, ne feront
que déplacer dans le temps
les problèmes.
La zone euro vit une
situation paradoxale. Prise
globalement, celle-ci est
loin d’être la zone du monde
la plus endettée. Son déficit
public en 2011 n’était que de
4,1 % rapporté à son PIB, un
déficit faible comparé à ceux
des États-Unis (8,5 %), du
Royaume-Uni (8,3 %) ou du
Japon (8,2 %). L’endettement
global de la zone euro est de
87,2 % du PIB, contre 99,6 %
pour les États-Unis et 239 %
pour le Japon. C’est pourtant
en Europe que se concentrent
les plus grandes méfiances et
spéculations. Instituée par le
traité de Maastricht en 1992,
la construction de la monnaie
unique a maintes fois été décriée
par de nombreux économistes
qui pointaient l’absence
de politique économique
européenne, celle-ci se résumant
à la stabilité monétaire et donc
à des limitations arbitraires des
déficits publics (3 %) comme
de l’endettement (60 %). Point
d’orgue de cette construction,
la BCE est la seule banque
centrale au monde qui se voit
interdire de financer les budgets
publics.
Ce paradoxe explique sans
doute les crises à répétition.
Supposons que les investisseurs
aient un doute sur la capacité
de remboursement d’un pays
de la zone euro, ceux-ci vont se
détourner de ses obligations qui
ne trouveront plus preneur sur le
marché et verront alors leur taux
d’intérêt s’envoler. Au moment
de rembourser ces obligations,
les États doivent généralement
réemprunter en émettant de
nouvelles obligations. Si la
banque centrale est dans
l’incapacité d’acheter cellesci,
l’État est alors à la merci
des marchés qui peuvent très
bien refuser de lui prêter ou lui
prêter à des taux prohibitifs de
l’ordre de 33 % comme on a pu
le voir dans le cas de la Grèce.
Voilà pourquoi cette interdiction
faite à la banque centrale de
financer les budgets publics,
fragilise l’Union européenne
qui se voit obligée d’organiser
sommet de crise après sommet
de crise, de monter en toute
hâte des pare-feux tels que le
Fonds européen de stabilité
financière (FESF) et maintenant
le Mécanisme européen de
stabilité (MES), alors que les
déficits et endettements de la
zone euro sont loin d’être les
plus importants au monde.
Une prophétie
autoréalisatrice
Lors du débat de 2005 sur le
traité constitutionnel européen,
les antilibéraux ont été les
seuls à mettre en lumière cette
anomalie qui plombe aujourd’hui
le fonctionnement même de
l’économie de la zone euro.
Aujourd’hui, les États européens
sont désormais pieds et poings
liés aux marchés financiers, les seuls légalement capables de
financer leur déficit. La seule
façon de rassurer les marchés
consiste à tenter de réduire
le déficit par une baisse du
budget de l’État en diminuant
le nombre de fonctionnaires, en
baissant salaires et pensions,
en privatisant les entreprises
publiques. Pourtant cette
politique ne marche pas ! La
Grèce, pays de loin le plus
touché, s’enfonce année après
année dans la récession. En
2012, son PIB baissera encore
de 5 % après trois années
consécutives de baisse. Au
total, le pays enregistre une
diminution du PIB de plus
de 13 % en quatre ans ! Au
deuxième trimestre 2012, il
apparaît que l’ensemble de la
zone euro frôle la récession. Le
Portugal (-3,3 %), l’Espagne
(-1 %), l’Italie (-1,3 %) et la
Belgique (-0,1 %) la vivent
en direct, la France (+0,4 %)
et l’Allemagne (+0,6 %)
pouvant à peine rééquilibrer
l’ensemble. Or lorsque le
PIB se réduit, les ressources
fiscales se contractent encore
plus fortement, renforçant ainsi
l’endettement du pays au lieu
de le réduire.
L’économiste Keynes a
expliqué dans l’entre-deuxguerres
combien il est
dangereux de vouloir à tout prix
rétablir l’équilibre budgétaire
de l’État. En période de déprime
généralisée, les entreprises
anticipant une mauvaise
conjoncture ont intérêt à ne pas
embaucher, à ne pas se lancer
dans des investissements.
Pris isolément, ils ont raison.
Pris dans leur ensemble,
ces attitudes contribuent
à créer une récession,
suivant ainsi le processus
classique de la « prophétie
auto-réalisatrice ». C’est la
raison pour laquelle Keynes
voyait dans l’État un agent
économique suffisamment
puissant pour aller à contrecourant
du marché et
renverser la tendance. Mieux
vaut aujourd’hui un déficit
pour remettre une économie
sur la voie de la croissance
– croissance qui permettra
d’engranger demain de
meilleures recettes fiscales qui
combleront le déficit passé.
Régime sec
Les recettes keynésiennes ont
été oubliées durant ces trente
années de néolibéralisme et
les gouvernements comme
les marchés sont à cours de
solutions de rechange. « Soyez
raisonnables, demandez
l’impossible », le vieux slogan
de mai 1968 semble être
devenu le voeu pieux du monde
de la finance. Puisque la
relance par le déficit budgétaire
est maintenant interdite, la
classe politique recherche des
solutions miracles de retour à la
croissance. La première porte
sur la compétitivité du travail,
entendue essentiellement
comme baisse du « coût » du
travail. C’est ainsi que dès
2011, le budget grec mise
sur l’attractivité du pays pour
capter les capitaux étrangers
et ce, même si cette attractivité
doit par ailleurs creuser le
déficit. C’est ainsi que la TVA
« touristique » (une innovation
grecque) a diminué de 11
à 6,5 %, que l’impôt sur les
sociétés est passé de 24 à
20 % et que les conventions
collectives ont été suspendues.
Même recette en Irlande pour
l’élaboration du budget 2011.
Pendant que l’État s’amputait
de 24 750 fonctionnaires et
augmentait le taux de TVA,
le taux de l’impôt sur les
sociétés particulièrement bas
de 12,5 % était maintenu et
le salaire minimum baissait de
8,65 % à 7,65 %. En France,
cette politique, certes un peu
moins accentuée, a pris la
forme de la loi Sarkozy sur
la « TVA sociale ». L’enjeu
étant de compenser la baisse
des cotisations patronales,
à la charge des entreprises,
par la TVA, à la charge des
consommateurs. Mais là
encore, et comme pour
la rigueur budgétaire, ces
mesures ont eu des effets
récessifs. En abandonnant
cette TVA sociale, le nouveau
gouvernement de gauche
montre qu’il n’entend pas,
pour le moment, céder aux
sirènes des libéraux sur le
thème du « coût du travail ».
De même, au moment de
l’annonce des réductions
d’effectifs chez PSA et de la
fermeture du site d’Aulnaysous-
Bois, le gouvernement
n’a pas jugé bon de répondre
aux demandes du patronat
sur la réduction du coût du
travail. Notons au passage
que l’équipe Ayrault n’a pris
aucune mesure directe contre
les réductions d’effectifs, son
plan portant essentiellement
sur des mesures d’incitation
à l’investissement dans les nouveaux véhicules
électriques et hybrides.
Project Bonds
Autre solution pour « dynamiser
» l’économie : le recours aux
partenariats public-privé (PPP)
(voir encadré). Parti renégocier
le traité européen de discipline
budgétaire auprès d’Angela
Merkel, François Hollande est
revenu bredouille. Seul point de
consensus : les Project Bonds.
Puisque les capacités d’endettement
des États sont nulles ou
presque, ce sont les sociétés
privées de PPP qui s’endetteront
auprès des marchés sous
forme d’obligations de projets,
sécurisées par la Banque européenne
d’investissements (BEI).
Cette institution prévoit ainsi de
lever 236 millions d’euros pour
pouvoir garantir 4,6 milliards
d’euros en vue de réaliser 5 à 10
grands travaux pour les infrastructures
transfrontalières. Au-delà
de ces grands travaux européens
financés par le privé avec
la garantie du secteur public, ce
sont des centaines de projets
PPP qui fleurissent dans toute
l’Europe pour financer des hôpitaux,
des lignes à grande vitesse
et même des prisons. Pourtant,
le coût final d’un PPP est toujours
supérieur à son équivalent
public. Comment croire que l’utilisation
de cet outil répond à la
crise de la dette ? Ne sommesnous
pas en train de transformer
une crise de la dette publique
en crise future des PPP, dans
laquelle les pouvoirs publics
seront dans l’impossibilité d’honorer
leurs engagements ? Cela
ne ferait donc que déplacer un
problème plus fondamental de
répartition des richesses qui fait
que les prêteurs auront de plus
en plus de mal à valoriser leur
créance auprès d’une majorité
démunie de la population. Tel
est désormais le cercle infernal
dans lequel se débat l’économie
européenne. Prise en otage
par la finance dans le cadre de
traités contraignants et difficilement
modifiables, elle se voit exiger
de retrouver le chemin de la
croissance sans pouvoir recourir
au déficit budgétaire, équation
impossible à tenir. La zone
euro arrivera-t-elle à tenir face
aux exigences incohérentes des
marchés ou devra-t-elle contourner
les traités en transformant le
futur MES en banque – ce que
laissent entendre de nombreux
dirigeants européens. À moins
que les blocages institutionnels
et l’impossibilité de trouver un
consensus ne conduisent à
l’éclatement de la zone euro…
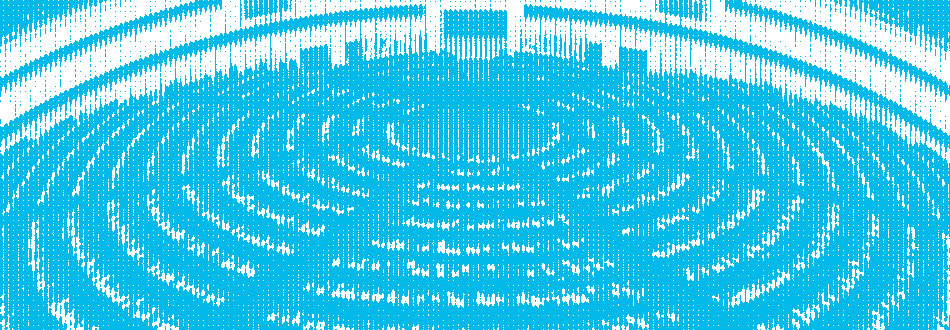

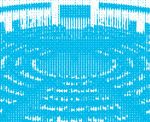

Laisser un commentaire